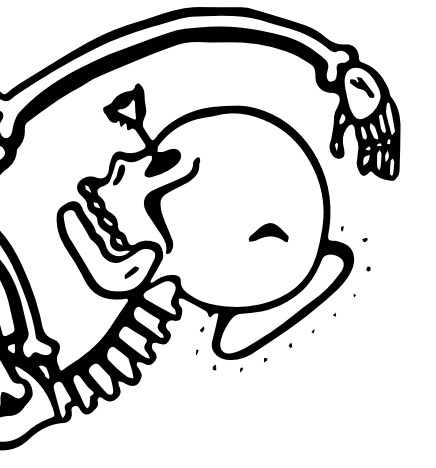La culture, c’est la mort ?
Et oui, les statues meurent aussi
« Quand les statues sont mortes, elles entrent au musée »
« Lorsque les hommes sont morts, ils entrent dans l’histoire. Quand les statues sont mortes elles entrent au musée. C’est cette botanique de la mort que nous appelons la culture. » Ces jolies phrases, non pas un tantinet morbides, sont toutes droites tirées d’un court-métrage des années 1950, (que je vous conseille fortement de visionner) cocréé par Chris Marker et Alain Resnais, intitulé « Les statues meurent aussi ».
Ce film est réalisé à la demande du collectif « présence africaine ». C’est une œuvre anticolonialiste qui a pour objectif de mettre en avant l’art africain, et de ne pas le laisser tomber dans l’oubli. Ce film remet en question la vision de l’art centrée sur l’Occident, ne laissant pas de place aux œuvres africaines au Louvre et les reléguant seulement dans des musées sur l’homme ou sur l’anthropologie. Au moment de la sortie du film, la décolonisation n’en est qu’à ces balbutiements. Serez-vous donc vraiment étonnés de savoir que le film a été censuré ? Effectivement, un tel discours ne convenait pas ! le film est cependant conservé, mais mettra 10 ans à sortir sur les écrans et en copie tronquée qui plus est !
La citation autour de laquelle nous allons réfléchir est l’ouverture de notre court-métrage. Elle s’articule en trois phrases et touche trois grands thèmes : la culture, la mort et l’histoire. Le tout enrobé à la lumière de ce que je tentais d’expliciter auparavant : la vision muséale occidentale et le refus de laisser entrer l’art africain dans nos musées des Beaux-Arts. D’après nos deux cinéastes, le lien entre l’histoire et la mort parait particulièrement fort. Effectivement, si nous suivons une conception événementielle de l’histoire, on remarque une très forte mise en avant de l’action des grands hommes (mettant à l’écart les femmes évidemment, sinon c’est pas drôle). Bon, pour concevoir l’histoire, il est vrai qu’il est nécessaire de faire un mouvement de questionnement du présent vers la passé (jusqu’ici, ça va). Ce n’est pas le passé en lui-même qui intéresse l’historien mais les actions humaines, les faits sociaux et politiques considérés à travers une variable : le temps. Une fois qu’on a notre gigantesque bloc d’informations, on le rapporte dans un récit organisé selon une chronologie. Par conséquent, ce qui ne fait plus partie du présent, c’est mort, non ? Il y a donc un lien indéfectible entre l’histoire et la mort.
La seconde phrase de notre super citation est construite comme la première, remplaçant « homme » par « statue » et « histoire » par « musée ». Quand on l’entend (ou qu’on la lit) elle fait un drôle d’effet. D’abord par l’écho qu’elle produit, mais aussi et surtout, parce qu’elle donne à un objet inanimé un aspect vivant. Ajoutons qu’elle fait du musée un lieu où l’histoire se conserve, voire où l’écriture de l’histoire se fait à travers les objets.
« C’est cette botanique de la mort que nous appelons la culture. » La métaphore suggérée par le mot « botanique » est intrigante. Cicéron est le premier à faire ce rapport entre botanique et humain (et Cicéron, ça date), il écrit « Un champ, si fertile soit-il, ne peut être productif sans culture, et c’est la même chose pour l’humain sans enseignement. ». Se lancer dans une définition de la culture, ça fait flipper, mais la réduire à « botanique de la mort », ça fait flipper aussi non ? Etymologiquement, culture vient du latin « colere » qui signifie « mettre en valeur » (ça marche autant pour un champ que pour un esprit). La culture est le point de départ de l’épanouissement de formes multiples de civilisations.
Elle est devenue l’ensemble de normes collectives mais aussi ce que certains appellent le « raffinement individuel ». Le mot culture désigne ce qui est différent de la nature, ce qui est commun à un groupe d’individu, ce qui englobe tous les arts, lettres, sciences, modes de vie, systèmes de croyances, de valeurs, de traditions… (cher lecteur, si cette définition n’est pas assez exhaustive à vos yeux, laissez-moi vous diriger vers une liste de plus de 150 définitions différentes de la culture dégagée par Alfred Kroeber et Clyde Klukhon, « culture, a critical review of concepts and definitions. »)
La culture, c’est du présent !
D’un point de vue sociétal et dans le domaine artistique du spectacle vivant, la culture a l’air d’être le fait des vivants et non pas des morts. Elle est ce qui règle les interactions entre les individus d’une société. C’est ce qui nous lie dans un instantané.
Si on consacre la culture comme le fait des morts, alors seulement certaines œuvres d’art y entrent, et les autres sont oubliées. Ce ne serait que celles qui sont de l’ordre du figé et résistent au temps qui pourront perdurer. La mise en scène d’une pièce de théâtre est vouée à disparaitre. Ephémère, elle n’est le fait que d’un instant… avant de s’évanouir. Pourtant, elle fait partie de notre grand groupe qu’est la culture ! Pour Hegel, la culture est un processus historique au cours duquel l’homme apprend à connaître et à dominer la réalité. Il imprime sa marque au monde par son activité. La culture individuelle peut se concevoir comme la capacité à comprendre la réalité du présent, au lieu de la subir. La culture n’est donc pas nécessairement le fait de la mort (chouette). Elle régule d’un point de vue anthropologique et sociologique les normes et valeurs d’une société.
Mais… il est vrai que pour obtenir ce présent dans lequel nous évoluons, avec nos représentations théâtrales adorées et nos habitus sociétaux, il est nécessaire de passer par un entretien de ce que les générations passées laissent pour la postérité.
Entretenir et figer : le fait de la mort
Pour reconstituer l’histoire, il est vrai qu’on fait une sorte de botanique. On entretient les traces laissées pour la postérité dans un but éducatif. L’historien cherche à constituer une connaissance, il n’y aurait pas d’histoire sans prise en considération de la mort des hommes et de l’écriture de récits qui en découlent. On entretient la mémoire, comme on entretient des plantes. Par conséquent, on fait des choix dans ce qu’on entretient, dans ce qu’on veut garder ou non. Refuser l’entrée au musée de certaines œuvres, c’est leur refuser une mémoire. Faire entrer des œuvres d’art dans un musée d’anthropologie, sans les considérer comme telle, c’est les mettre dans une position d’infériorité. La culture se fait par la mort puisqu’elle fait partie de l’histoire. Paradoxalement, l’objectif est de ne pas laisser les traces et les souvenirs mourir. C’est cette angoisse de la mort et de la fin qui va pousser l’homme à laisser des traces de son passage.
Le désir de laisser des marques
Le fait de maintenir cette botanique de la mort permet à l’homme d’atténuer ses angoisses. La mort n’est pas seulement un fait biologique pour l’homme, c’est aussi le seul animal qui sait qu’il doit mourir. Il est le seul pour qui la mort inscrit la vie dans la précarité. Et ça, c’est source d’angoisse !
Première solution, y opposer une croyance, se rassurer avec la possibilité d’avoir une autre vie dans l’au-delà, un après, une continuité, et non pas une fin brutale et violente qui donne envie de faire pipiculotte. Sinon, on peut se réfugier du côté des existentialistes par exemple, qui placent la mort au centre de leur réflexion, comme un horizon qui permet à la vie humaine de prendre son sens.
Ce désir d’immortalité (du fait de la conscience d’une mort certaine), se transforme en désir de création. Grâce au domaine artistique, l’homme se voit offrir en miroir la possibilité d’une forme d’immortalité. Et d’autant plus quand il sait qu’il y a la possibilité d’une « botanique de la mort », là pour entretenir les marques laissées pour la postérité. Quand on laisse une sculpture, un film, une peinture derrière soi, on se voit offert une vie qui s’allonge. De plus, parfois, c’est la mort qui permet de prendre conscience de l’œuvre d’un artiste. Cela dépend de 2 critères. Soit l’œuvre est ancrée dans son époque et correspond aux codes attendus et risque alors d’être oubliée au milieu d’une production démultipliée… soit elle ne s’y inscrit pas. Cela est le fait d’artistes que l’on considère comme de véritables génies proposant des œuvres originales et atteignant un but qui n’était pas accessible aux autres, mais qui serait resté incompris par ses contemporains, le lot des avant-gardistes et d’un nombre trop restreint et élitiste d’individus pour que je m’y penche plus longtemps. Cette vision du génie incompris est à prendre avec d’énormes pincettes, c’est vraiment le cas d’exception de se voir magnifier par la mort sans avoir été compris de son vivant. Et puis, parfois on crée cette exception de toute pièce, en montrant des œuvres comme des annonciations ou des divinations des mouvements artistiques qui arrivent ensuite… c’est très fumeux de percevoir les artistes comme cela et nous éloigne de la réalité. Bref, je digresse et me disperse.
Finalement, la culture, c’est la mort dans le présent
Cette botanique de la mort entretenant l’activité humaine a quelque chose de rassurant en ce qu’elle permet à l’homme d’atteindre une immortalité relative et une connaissance de son passé. Mais imaginez que l’on refuse d’entretenir votre botanique ? Comme ce qu’il se produit dans le contexte du film de nos chers Alain Resnais et Chris Marker. On refuse à l’art africain d’entrer au Louvre, comme on refuserait à des corps d’entrer au cimetière et que l’on jetterait dans la fosse commune, autrement dit, dans l’oubli.
La culture se fait nécessairement par la mort, bien qu’elle soit le fait du présent. Cette botanique de la mort est reconstituée par les historiens. Ils agglomèrent des connaissances et en préservent la mémoire, qui, sans cet entretien, se fane inexorablement. Alors oui, j’ai tendance à croire que la culture, c’est la mort… mais c’est aussi la vie. C’est en ce paradoxe que réside toute la problématique du court-métrage, il faut apprendre à agir sur la question des entrées ou du refus d’entrées d’œuvres au musée. Cette problématique est encore actuelle, dans les questions de restitution d’œuvres volées durant la période colonialiste notamment. Cette culture est le fait du présent puisqu’elle doit être préservée, entretenue et surtout mise en avant. Elle constitue l’identité des peuples et des nations.
Aujourd’hui, l’art africain a éventuellement fini par entrer au Louvre, presque 50 ans après la sortie du film qui nous intéresse ! Effectivement, c’est au début des années 2000 qu’une centaine d’œuvres ont été placées dans le musée. Pour fêter cela, citons Guillaume Apollinaire « le Louvre devrait accueillir certains chefs d’œuvres exotiques dont l’aspect n’est pas moins émouvant que celui des beaux spécimens de la statuaire occidentale ». Cependant, ce n’est pas tout de laisser entrer des œuvres au musée, maintenant qu’elles ont leur tombeau, encore faut-il savoir leur attribuer la stèle appropriée. Bien souvent, les œuvres extra-européennes sont mal exposées en plus d’avoir été volées, infériorisées, mal-aimées ou laissées sur le pas de la porte. Justement, ces pièces ne correspondent pas à notre culture et nous ne les lisons pas bien, nous mettons en avant leur aspect esthétique sans raconter leur histoire, ou les utilisons comme illustration à une histoire sans mettre en avant leur esthétisme.
Il serait temps de questionner notre façon de créer notre mémoire, dans la façon que nous avons de voler celle des autres, de la laisser s’effacer et prioriser notre façon de collectionner à l’infini des éléments.
Bref, y a tout à revoir dans notre regard.